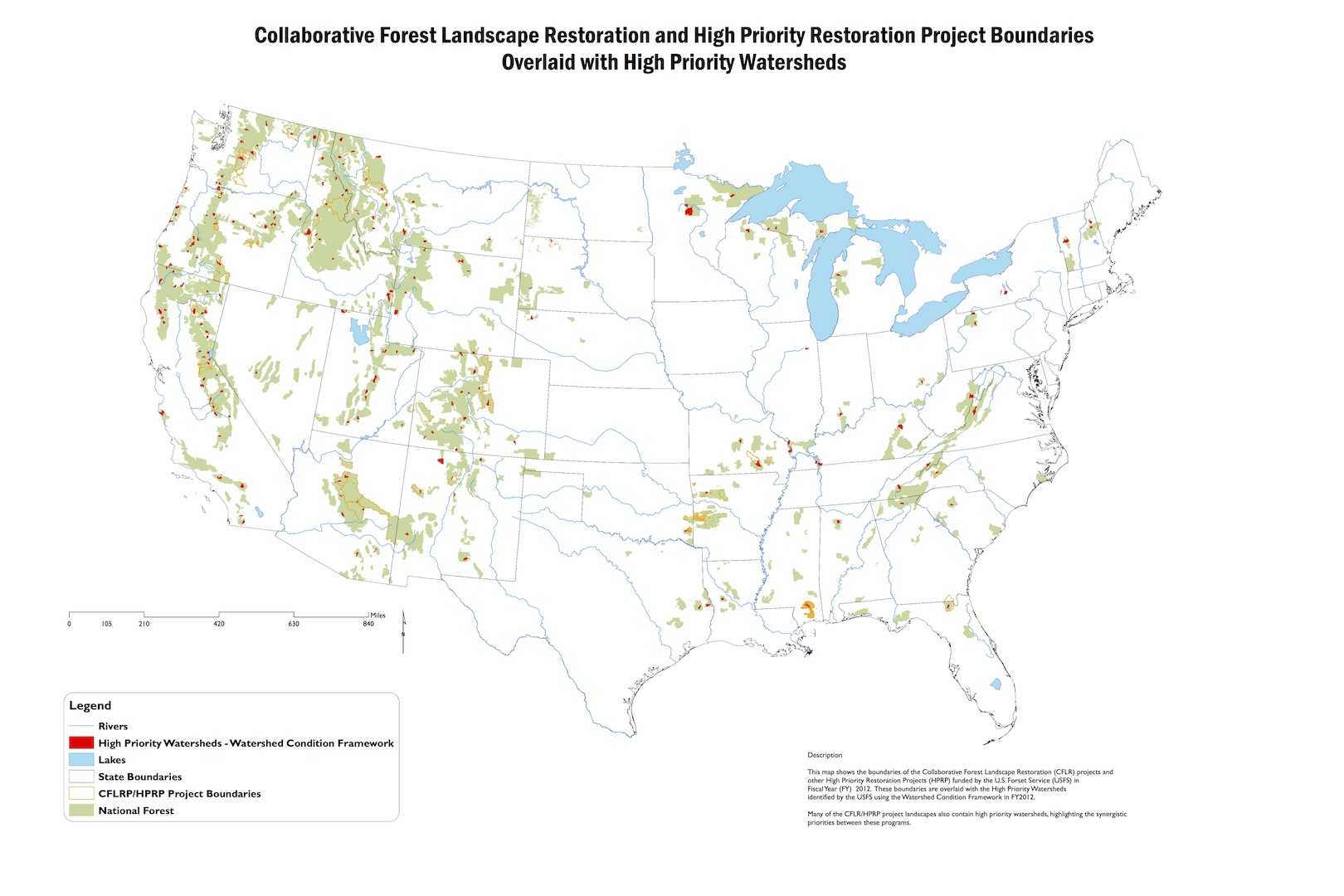Dans l’édition de mars-avril 2013 de la revue Forestry Chronicle, j’ai constaté avec un très grand regret le décès de M. Gordon L. Baskerville. Je n’ai pas personnellement connu M. Baskerville ou suivi ses cours. En fait, je n’ai fait que quelques lectures de ses écrits; des lectures qui ont toutefois fait une forte impression sur moi. Deux des chroniques (première, seconde) de ce blogue sont directement tirées de ses écrits; une troisième en a récemment été inspirée… et d’autres suivront certainement! Sans aucun doute un des grands aménagistes forestiers de l’histoire canadienne.
En guise d’hommage plus complet, les responsables du Forestry Chronicle ont eu la gentillesse de me permettre de vous faire partager le texte et les témoignages qui ont été publiés (en anglais). Qu’ils en soient remerciés.