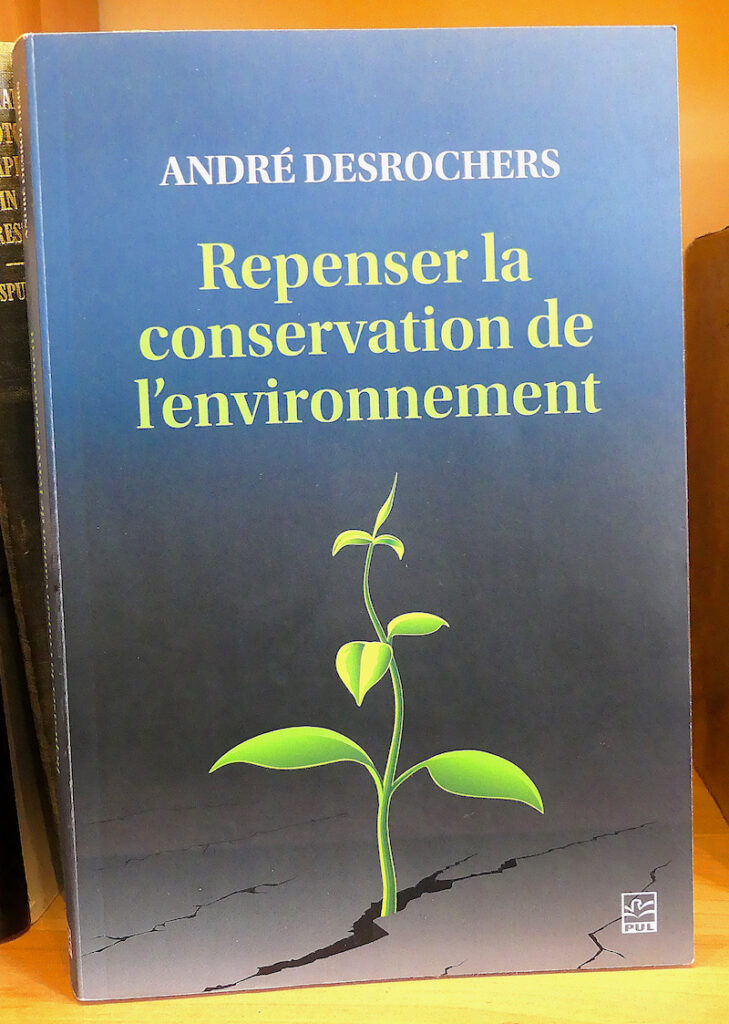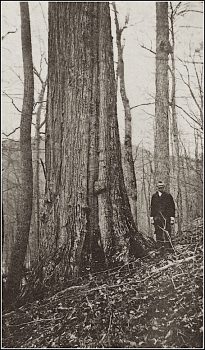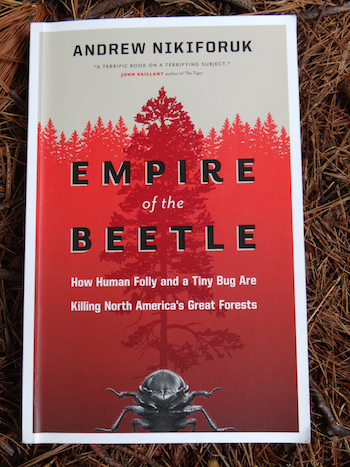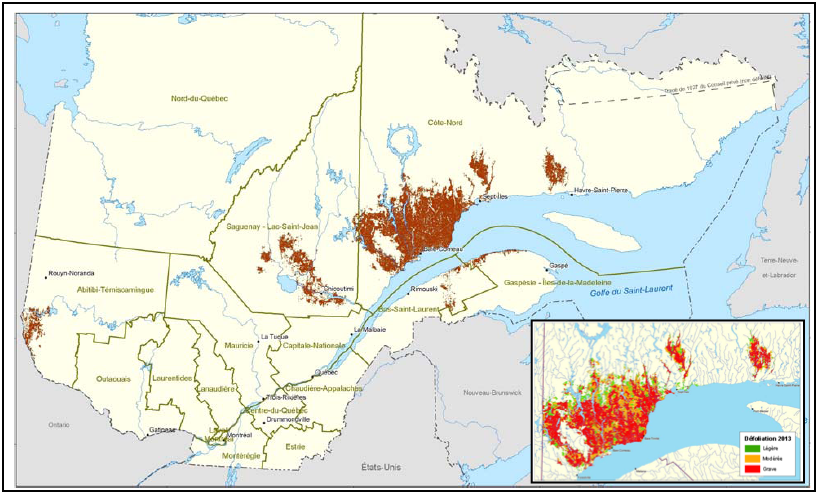Après un hiatus de plus de deux ans, de retour à un compte-rendu de livre! Et pour l’occasion, je mise sur du «local» alors que je vous présente «Repenser la conservation de l’environnement». Un livre écrit par André Desrochers, professeur à la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l’Université Laval, et publié en 2022 aux Presses de cette même université.
Je dois ici souligner que je connais André. Sans être des intimes, nous nous sommes croisés assez fréquemment pour que je pense à «André» et non pas à «M. Desrochers». Il est devenu professeur à la Faculté de foresterie au début des années 1990 alors que je complétais ma maîtrise. Par la suite, nous avons eu l’occasion de nous recroiser au cours de mon doctorat au début des années 2000. Notre dernière rencontre remonte à quelques années alors que nous étions conférenciers au même congrès.
C’est là le contexte personnel dans lequel j’écris ce compte-rendu.
Pour l’aspect professionnel, je dois avouer que si certains passages me font classer ce livre dans les «essentiels», d’autres peuvent décontenancer, voire même laisser songeur. Finalement, on tourne la dernière page sans être trop sûr de ce que l’on doit retenir de l’ensemble. La principale raison étant que le livre a été écrit tant par André Desrochers le chercheur qu’André Desrochers le citoyen politisé.
Détails…
Lire la suite