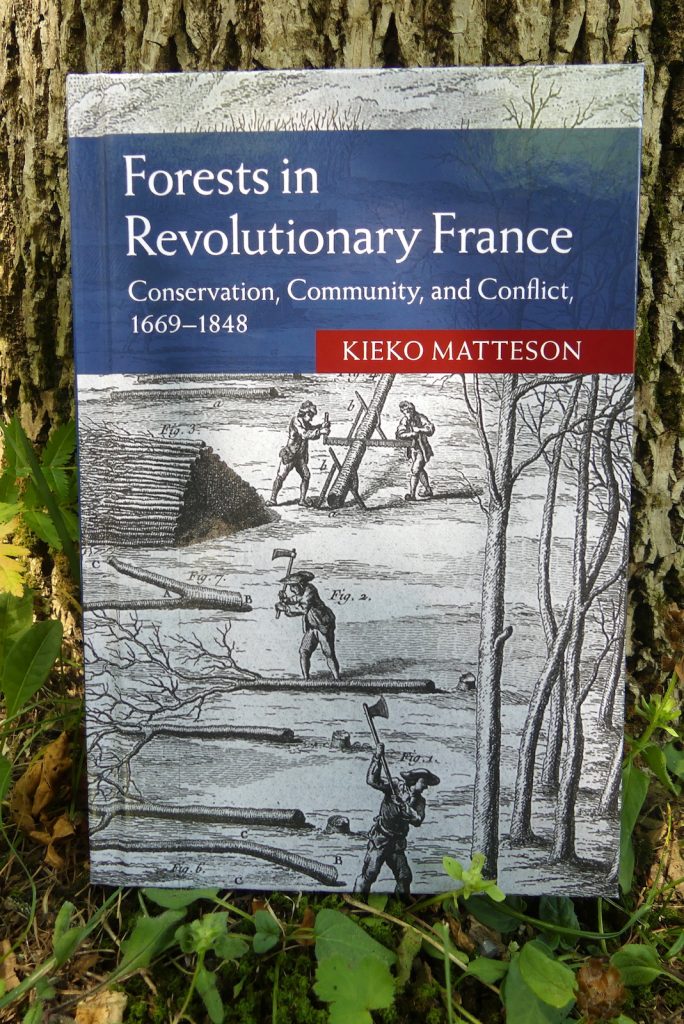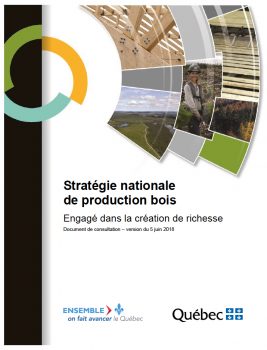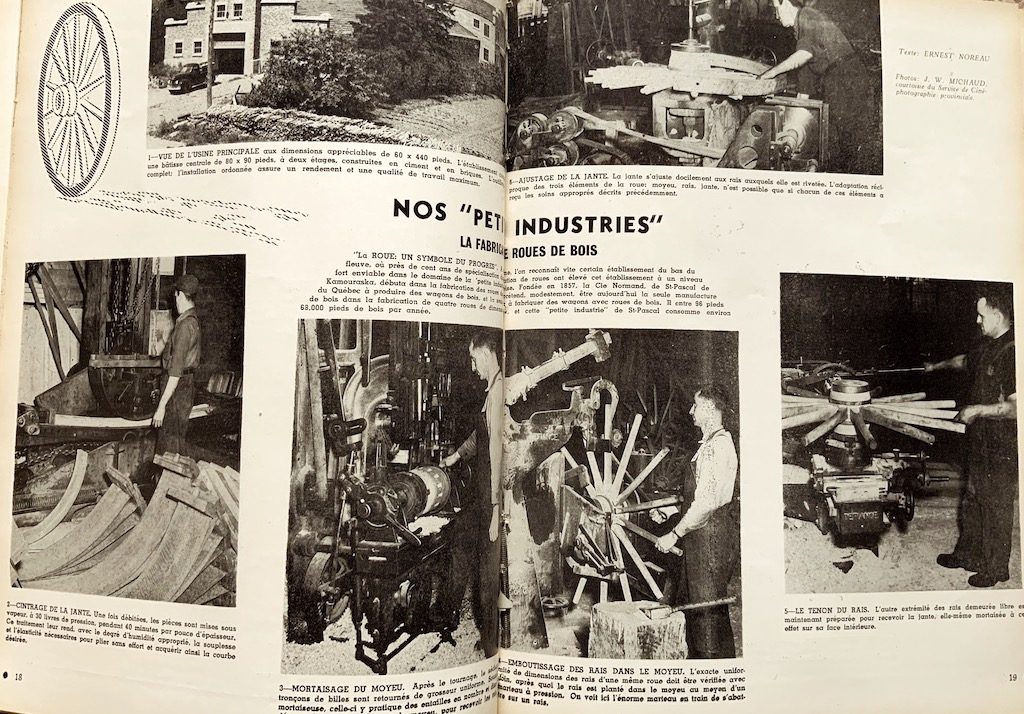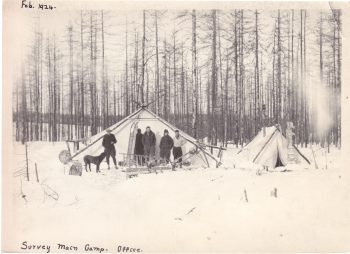Quatrième texte de la série Les Chroniques du caribou.

Ce texte devait porter exclusivement sur le caribou forestier (Rangifer tarandus caribou). J’allais m’appuyer sur une précédente chronique pour explorer plus à fond l’état de sa situation dans le contexte de l’arrivée des premiers colons européens au Québec au début du 17e siècle. Pour cela, j’ai lu (ou relu) les textes de cinq chroniqueurs de l’époque (Champlain, Sagard…).
Or, plus je lisais… moins j’en avais à dire sur le caribou forestier.
Il y avait des caribous forestiers. C’est clair. Mais ce n’était assurément pas l’abondance. Et les nations autochtones qui auraient dû s’y intéresser le plus, comme les Montagnais (Innus), n’en faisaient manifestement pas grand cas.
Dans ce contexte, essayer de parler du caribou forestier à cette époque m’amenait surtout à parler des autres espèces, bien plus présentes. Et… pourquoi pas? Le caribou forestier a pris tellement de place dans nos enjeux de biodiversité que l’on en oublie qu’il y a un monde qui existe autour. Et qu’il y a aussi une histoire que l’on connaît très mal. Au point même qu’il s’avère que nos efforts de rétablissement du caribou forestier devraient plutôt être orientés vers une autre (sous-) espèce.
Lire la suite