Lectures hivernales et forêts post-génocide
 Le livre étant édité, me voilà officiellement de retour au blogue !
Le livre étant édité, me voilà officiellement de retour au blogue !
Question de me mettre à jour avant de retrouver un rythme de production plus régulier, cette chronique se voudra avant tout une petite rétrospective des lectures qui m’ont le plus marqué depuis le début de l’année 2020. Chacune aurait pu faire l’objet d’une chronique individuelle, mais elles sont restées à l’état de projet, car le livre avait la priorité. Et malgré le côté a priori un peu hétéroclite de ma proposition d’aujourd’hui, le tout sera synthétisé par une réflexion.
Européens
Au mois de janvier dernier, fut publiée une étude intitulée Conservation implications of limited Native American impacts in pre-contact New England. Les résultats de cette recherche montrent que, sur une perspective de milliers d’années, seuls les Européens auraient eu une influence notable sur le paysage de la Nouvelle-Angleterre en ouvrant grandement le couvert forestier par le biais de l’agriculture. N’ayant pas détecté de traces équivalentes d’ouverture du couvert de la part des autochtones, les auteurs ont conclu que les mesures de conservation visant à s’inspirer du paysage avant le contact entre autochtones et « blancs » devraient cibler des forêts matures exemptes d’influence humaine.
L’aménagement des Amériques précolombiennes est un des sujets que j’ai développé ces dernières années. Jusqu’à présent, tout ce que j’ai pu lire sur le sujet allait dans un sens très opposé aux conclusions de cette étude. C’est pourquoi la thèse du territoire précolombien aménagé a été retenue dans une section de mon livre. Or, alors que je m’apprêtais à « geler » le texte pour l’envoyer à la graphiste, je me retrouvais dans la situation d’avoir potentiellement à intégrer les résultats d’une nouvelle recherche. Une décision qui devait être prise rapidement, car à ce moment je ne me doutais pas que le Salon du livre de Québec serait annulé et les délais commençaient à être serrés.
Finalement, et pour la courte histoire, j’ai jugé plus sage de laisser le temps décider de la place qu’aura (ou non) cette étude dans notre compréhension de l’aménagement des Amériques précolombiennes. Je devais cependant bien vite constater que cette retenue (ou sagesse) ferait de moi un bien piètre journaliste.
C’est le lundi 20 janvier que des comptes-rendus de cette étude ont été publiés sur des sites d’actualité scientifique. Le mardi 21 janvier, elle faisait la manchette du Newsweek avec l’intitulé [traduction] : « Les autochtones n’ont pratiquement pas eu d’impacts sur le paysage pendant 14 000 ans, et les Européens sont arrivés. »
Manchette spectaculaire si ce n’était qu’en 2019 une étude avec des objectifs comparables était arrivée à des conclusions opposées. On retrouve de plus dans cette dernière des éléments de méthodologie qui recoupent celle de janvier 2020, dont un horizon temporel de plusieurs milliers d’années.
Ces deux études se distinguent cependant sur deux grands points. Plutôt que de mesurer l’influence de l’aménagement des Premières nations par le biais de l’ouverture du couvert forestier, celle de 2019 s’est attardée à l’évolution des essences d’arbres dans le temps. Les auteurs ont alors conclu que seule une intervention humaine (avec le feu) avait pu maintenir l’abondance de certaines essences malgré des conditions climatiques défavorables à leur présence. Aussi, l’étude de 2019 avait pour territoire d’analyse toute la moitié est des États-Unis alors que celle de 2020 se concentrait sur la Nouvelle-Angleterre, avec une emphase le long de la côte maritime entre Long Island et Cape Cod. Bref, il y avait place à la nuance…
Le plébiscite médiatique de l’étude publiée en janvier, au détriment de celle de 2019 pour laquelle je n’ai pas noté une telle récupération, me laissa plusieurs questions en tête. Toutefois, le livre devait avancer et j’avais aussi deux autres projets de lectures d’intérêt professionnel.
Colonisation
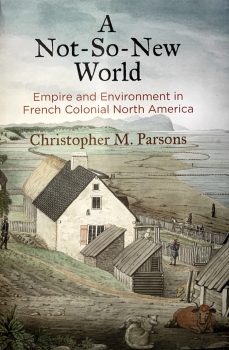 A not-so-new world: Empire and environment in French colonial North America (Christopher M. Parsons, University of Pennsylvania Press) se veut une formidable incursion dans l’esprit des colonisateurs français sous l’angle botanique. L’auteur s’attarde à deux grandes périodes, soit le début et la fin du Régime français.
A not-so-new world: Empire and environment in French colonial North America (Christopher M. Parsons, University of Pennsylvania Press) se veut une formidable incursion dans l’esprit des colonisateurs français sous l’angle botanique. L’auteur s’attarde à deux grandes périodes, soit le début et la fin du Régime français.
Dans les premiers chapitres, l’auteur relate le contact entre les premiers colons français, dont Samuel-de-Champlain, et une flore qui ressemblait à celle qu’ils connaissaient (« un monde pas si nouveau »). À tout le moins, ils pouvaient facilement faire des liens avec des espèces connues en France (les raisons sont détaillées).
L’intuition initiale des colonisateurs français fut alors que bien des essences d’arbres et de plantes rencontrées dans ce coin d’Amérique n’étaient que des versions sauvages de celles qui poussaient en France. Ils en conclurent donc qu’il suffirait d’un peu de patience pour pouvoir cultiver une réelle Nouvelle-France. Évidemment, avec le temps, la réalité propre à ce territoire rattrapa les Français. Si l’élite française était enthousiaste aux débuts, vers la fin, il était acquis que ce nouveau territoire était bien distinct de la mère-patrie.
Pire, les canadiens, soient les Français d’origine nés dans la colonie, avaient une fâcheuse tendance à « s’ensauvager » au contact des Amérindiens et à partir en forêt. Cela, au grand dam du clergé qui souhaitait créer des paroisses en liant les colons à la terre par le biais de l’agriculture. Selon l’auteur, ce changement de sentiments vis-à-vis la Nouvelle-France a potentiellement influencé le sort qui devait être réservé au Canada à la suite de la guerre de Sept Ans qui vit la France le céder à l’Angleterre.
Parmi les nombreux autres points d’intérêt de ce livre, il y a le fait que les missionnaires Jésuites misaient beaucoup sur les Wendats et les nations de la confédération iroquoise (Haudenosaunee) dans leurs efforts de conversion à la foi catholique. La raison principale étant qu’il s’agissait de sociétés agricoles et l’agriculture était à la base de la société que souhaitaient bâtir les autorités françaises (dont le clergé).
Il y avait cependant une différence culturelle notable avec la vision du clergé : il s’agissait de sociétés matriarcales. Plus encore, l’agriculture et la connaissance de l’écologie des plantes, dont les propriétés médicinales, étaient une chasse gardée féminine.
De fait, les femmes iroquoises ne partageaient pas leurs connaissances avec les hommes de leur nation… Encore moins avec des missionnaires qui souhaitaient établir des sociétés patriarcales avec l’homme en tant que responsable de l’agriculture ! Conséquemment, il y a des pans entiers de l’aménagement du territoire par les sociétés iroquoises dont les missionnaires ont été gardés à distance (note : on leur doit beaucoup de nos connaissances sur les nations autochtones). Entre autres, la sélection préférentielle de plantes et les brûlages dirigés pour favoriser certains arbres fruitiers.
En résumé, un livre fascinant pour quiconque s’intéresse à l’histoire du Canada et la Nouvelle-France. Dans cette même veine, mais avec une perspective temporelle beaucoup plus longue, il y a le très bon La Préhistoire du Québec (Patrick Couture, Fides).
Préhistoire
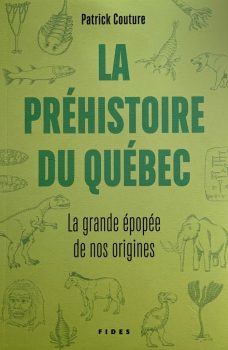 Si vous vous intéressez à la « grande » (longue) histoire, soit à l’échelle géologique, il peut être difficile de savoir qu’est-ce qui s’applique vraiment au territoire québécois. C’est là une des grandes qualités de La Préhistoire du Québec : ramener la très longue histoire de la planète selon une perspective « québécoise » (appellation très récente). De plus, l’auteur étant un très bon conteur, la lecture est fort agréable.
Si vous vous intéressez à la « grande » (longue) histoire, soit à l’échelle géologique, il peut être difficile de savoir qu’est-ce qui s’applique vraiment au territoire québécois. C’est là une des grandes qualités de La Préhistoire du Québec : ramener la très longue histoire de la planète selon une perspective « québécoise » (appellation très récente). De plus, l’auteur étant un très bon conteur, la lecture est fort agréable.
Pour la petite note technique, la distinction entre l’histoire et la « pré-histoire » est l’écriture. Tant qu’il n’y a pas d’histoire écrite, on reste dans la préhistoire. C’est pourquoi l’auteur précise que la préhistoire de l’actuel territoire québécois s’est terminée aussi tard qu’en 1534 avec l’arrivée de Jacques Cartier.
Pour donner une perspective de la « grande » histoire dont il est question dans ce livre, le premier chapitre s’intitule « Il y a 4,3 milliards d’années : Le sol québécois ». On y apprend, entre autres, que les plus anciennes traces de la croûte terrestre originale ont été découvertes au Nunavik en 2017 et datent de 4,2-4,3 milliards d’années. Au chapitre suivant, on découvre que les plus anciennes traces de vie sur Terre, des bactéries datant d’environ 4 milliards d’années, ont été découvertes sur la côte est de la baie d’Hudson… Le Québec héberge une longue histoire de vie !
À partir de là, on va suivre le « Québec » dans son épopée tectonique. De fait, les continents se déplacent constamment. Pour un exemple, il y a 430 millions d’années, ce qui est aujourd’hui le Québec était tout près de l’équateur ! De quoi faire rêver les snowbirds 🙂
Naturellement, il y est aussi question de l’évolution de la faune et de la flore qui ont occupé le futur territoire québécois, ainsi que de la présence des premiers hommes. Au Québec, les premières traces humaines datent de 12 500 ans et ont été découvertes dans la région du lac Mégantic. Pour la mise en contexte écologique, cette région ressemblait alors à une toundra herbeuse et ce qui est aujourd’hui la ville de Québec était sous la mer de Champlain !
En résumé, une passionnante épopée, très facile à lire et que je vous recommande grandement.
Génocide
Finalement, je vais exceptionnellement vous présenter un extrait d’un livre que j’ai lu cet hiver par simple intérêt personnel. Il s’agit de Four futures : Life after capitalism (Peter Frase, Verso). L’auteur explore comment pourraient évoluer les sociétés après le capitalisme.
C’est un livre très abordable et ne nécessitant pas de connaissances en économie. Il fait d’ailleurs de fréquentes analogies à la culture populaire, comme Star Trek dans le chapitre sur le communisme. Mais c’est dans le chapitre sur « l’exterminisme », soit le partage des richesses au bénéfice d’un petit nombre, qu’il exprime un point de vue qui m’a particulièrement frappé en lien avec mes réflexions de blogueur :
En tant que descendant d’Européens aux États-Unis, j’ai une idée de ce que cela pourrait être [l’exterminisme]. Après tout, je suis le bénéficiaire d’un génocide.
Ma société a été fondée sur l’extermination systématique des premiers habitants du continent nord-américain. Aujourd’hui, les descendants survivants de ces premiers Américains sont suffisamment appauvris, peu nombreux et géographiquement isolés pour que la plupart des Américains puissent facilement les ignorer dans leur vie. Il arrive que leurs survivants s’imposent à notre attention. Mais surtout, si nous pouvons déplorer la brutalité de nos ancêtres, nous n’envisageons pas de renoncer à notre vie prospère ou à notre terre. Comme l’a dit [Herbert] Marcuse, personne ne s’est jamais soucié des victimes de l’histoire. (p. 149, traduction à l’aide de Deepl.com)
Si le mot « génocide » vous choque ou vous semble exagéré, j’ai vérifié la définition dans mon dictionnaire (Larousse, 2008) et l’on peut y lire l’exemple suivant : « […] On l’emploie également pour désigner l’extermination des populations amérindiennes par les conquérants européens et pour caractériser les massacres à grande échelle […] »
Pour le rappel historique, lorsque les Européens sont arrivés dans les Amériques, il y a un peu plus de 500 ans, ils ont (involontairement) apporté des maladies qui ont causé des taux de mortalité de l’ordre de 80 % à 90 % dans les sociétés indigènes (selon les chiffres qui font consensus aujourd’hui). En chiffres absolus, cela se serait traduit en des dizaines de millions de morts en relativement peu de temps. Une tragédie qui pourrait même se transformer en marqueur d’entrée dans l’anthropocène, car l’aménagement du territoire ayant fort diminué, cela occasionna une croissance telle de la végétation qu’une diminution planétaire de CO2 s’en suivit. De plus, cette hécatombe plaça les nations indigènes en situation de faiblesse dans les conflits armés avec les « blancs »; conflits desquels ils sortirent grands perdants.
Note importante : ici, je ne fais que constater, je ne juge pas.
Réflexion
Toutes ces lectures m’ont ramené à mes questionnements du mois de janvier dernier à la suite de l’étude en Nouvelle-Angleterre concluant que les autochtones n’avaient eu aucune influence notable sur le paysage avant l’arrivée des Européens. J’avais alors eu à prendre une décision rapide sur l’inclusion ou non de cette recherche dans mon livre. Avec le recul, j’ai le sentiment d’avoir fait le bon choix. Je ne dis pas que cette étude n’a aucun mérite. Mais elle n’a assurément pas tous ceux que ses auteurs lui accordent.
Imaginez un instant un lieu habité pendant des milliers d’années par des humains. Un lieu reconnu pour avoir abrité de très fortes densités de population (le cas de l’actuelle Nouvelle-Angleterre). Maintenant, imaginez que pendant des milliers d’années ces humains n’aient eu aucune influence sur le paysage, zéro, nil. L’idée même apparaît absurde. Et je laisse à d’autres expliquer comment des scientifiques ont pu arriver à cette conclusion sans exprimer l’ombre d’un doute.
Toutefois, ce type de conclusion explique très bien comment on peut considérer que des forêts du 19e siècle représentent un paradis originel qu’il faudrait reproduire aujourd’hui (aménagement écosystémique). Nous sommes collectivement dans une logique d’évacuer toute histoire humaine en Amérique du Nord avant l’arrivée des Européens ; à tout le moins, toute histoire digne de ce nom. Or, si l’on voulait respecter l’histoire, les forêts du 19e siècle qui nous servent aujourd’hui de référence en tant que forêts primitives (ou préindustrielles) devraient plutôt être considérées pour ce qu’elles sont vraiment : des forêts post-génocide.
********
Lectures complémentaires
La variole, un ancêtre de la COVID-19: Les leçons de l’histoire (Denis Vaugeois, Le Soleil 18 avril 2020)
1491: New revelations of the Americas before Columbus (Charles C. Mann, Vintage Books)
Le pin blanc et l’humanisation historique des forêts des Amériques (La Forêt à Coeur)
Biodiversité et Anthropocène : protéger le passé à tout prix ? (La Forêt à Coeur)

