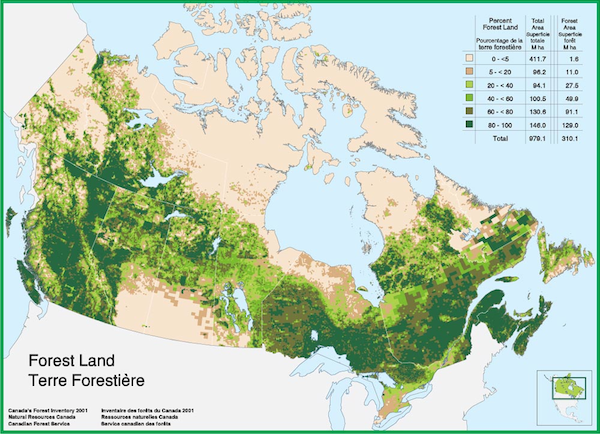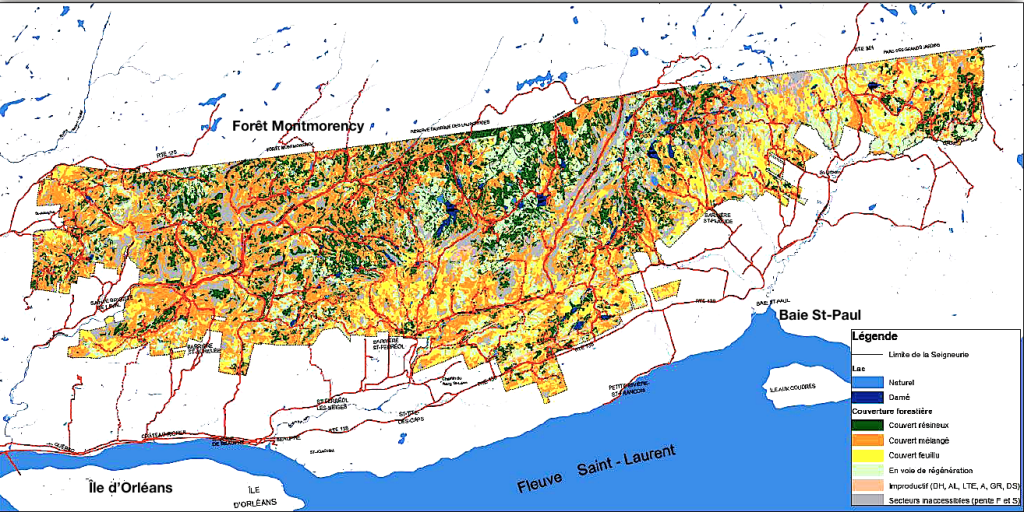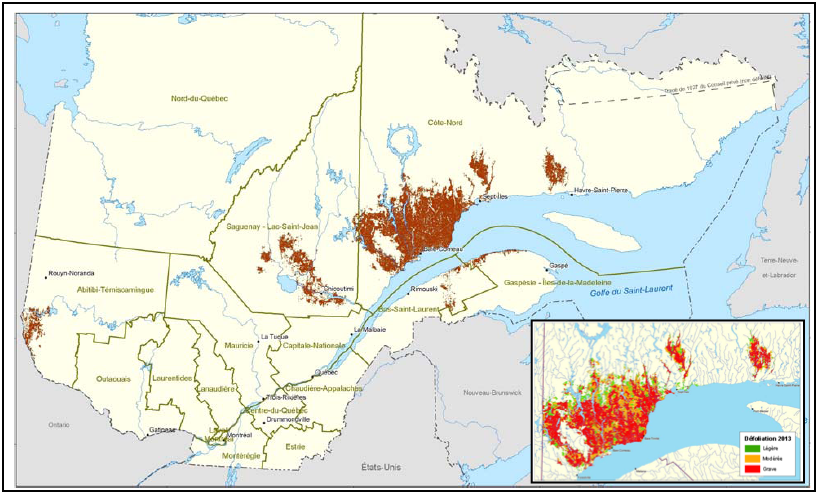(La Forêt à Coeur s’ouvre! Dans cette deuxième chronique, Véronique Yelle ing.f. Ph.D. discute de l’application du concept d’acceptabilité sociale. Quoique l’auteure est à l’emploi du MRN, cette chronique est faite à titre personnel. Pour en savoir plus sur l’auteure.)
(La Forêt à Coeur s’ouvre! Dans cette deuxième chronique, Véronique Yelle ing.f. Ph.D. discute de l’application du concept d’acceptabilité sociale. Quoique l’auteure est à l’emploi du MRN, cette chronique est faite à titre personnel. Pour en savoir plus sur l’auteure.)
Dans ma dernière chronique, je vous ai entretenu du concept d’acceptabilité sociale, en proposant une définition et en m’attardant sur les aspects individuels du jugement d’acceptabilité. La définition que je vous ai proposée comporte deux aspects importants : d’une part le jugement individuel et d’autre part, la capacité de groupes d’individus partageant un même jugement (et bien souvent les mêmes valeurs) à se faire entendre sur la place publique. C’est de ce deuxième aspect dont je traiterai ici : les groupes à prendre en compte dans l’acceptabilité sociale.
Prendre en compte l’acceptabilité sociale en amont
Dans une optique où on souhaite que des projets de développement des ressources naturelles respectueux des valeurs de la société voient le jour, il est préférable de s’intéresser à l’acceptabilité sociale en amont, c’est-à-dire avant que les différents groupes pour ou contre ne voient plus d’autres options pour se faire entendre que de faire pression publiquement sur les promoteurs ou les gouvernements. En fait, il faut sonder l’acceptabilité sociale avant même qu’il n’y ait une problématique quelconque.
Bien sûr, on peut attendre que les groupes pour ou contre un projet se manifestent sur la place publique, à savoir dans les médias traditionnels, dans les rues, sur les médias sociaux ou encore au tribunal. Toutefois, à ce moment-là, on se retrouve souvent dans une situation d’inacceptabilité sociale, à un moment où plusieurs personnes sont déjà mobilisées et où leur attitude (jugement d’acceptabilité) face à un projet est déjà cristallisée. Aujourd’hui, avec la rapidité de réseautage permise par le Web 2.0, l’opinion publique peut se rallier à une cause qui lui était encore inconnue quelques jours auparavant. Lorsque la mobilisation est forte, il devient très difficile de revenir en arrière, les relations entre les différents camps étant déjà tendues et la confiance minée. Comme une publicité ayant marqué mon enfance le dit si bien : on n’a pas une deuxième chance de faire sa première impression! Lire la suite