Le Guide sylvicole du Québec (compte rendu)
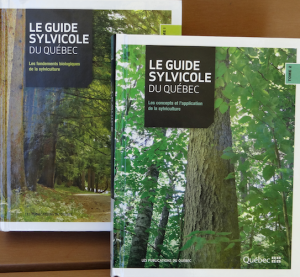 Le Guide sylvicole du Québec est certainement, depuis le Manuel de Foresterie en 2009, le document le plus attendu dans le monde forestier québécois. Les deux premiers tomes s’intitulent respectivement Les fondements biologiques de la sylviculture et Les concepts et l’application de la sylviculture. Ils ont été publiés cette année et ce sont ces deux documents qui seront la vedette de ce compte rendu. Le troisième tome s’intitulera Les scénarios sylvicoles et est attendu pour 2015.
Le Guide sylvicole du Québec est certainement, depuis le Manuel de Foresterie en 2009, le document le plus attendu dans le monde forestier québécois. Les deux premiers tomes s’intitulent respectivement Les fondements biologiques de la sylviculture et Les concepts et l’application de la sylviculture. Ils ont été publiés cette année et ce sont ces deux documents qui seront la vedette de ce compte rendu. Le troisième tome s’intitulera Les scénarios sylvicoles et est attendu pour 2015.
Fruit de la collaboration de plusieurs dizaines de chercheurs et praticiens du monde forestier, les deux premiers tomes totalisent plus de 1700 pages; une mesure de la somme de travail qu’a nécessité cet ouvrage qui est toujours en production. Face à une telle entreprise et à un résultat édité par Les Publications du Québec de très haute qualité, on ne peut être qu’admiratif. Le document est abondamment illustré de graphiques et de photos, rendant le tout agréable à consulter. Alors, à se le procurer au plus vite? Eh bien, ça dépend…
Les Tomes
Le Tome 1, en raison de sa mission de nous présenter les «fondements biologiques», recense très large, soit de l’autoécologie des essences commerciales et concurrentes, au recensement des principaux agents de perturbation naturelle (insectes, maladies, pollution atmosphérique, feux) en passant par la dynamique des peuplements et les végétations potentielles. Chaque thème apparenté (essences forestières, insectes…) a été développé selon une même structure facilitant ainsi la consultation. J’ai particulièrement apprécié la section sur les insectes avec les cartes de récurrence des épidémies. Une référence fort utile. J’ai toutefois été surpris de ne pas retrouver une carte sur les cycles de feux à l’échelle du Québec. C’est pourtant un élément de réflexion important quand vient le temps d’aménager une forêt.
Le Tome 2 présente ce qui m’apparaît le coeur du Guide sylvicole, soit les traitements comme tels. Même s’il fait tout de même 700 pages, il est assez aisé de le prendre dans une main pour le feuilleter de l’autre. Un aspect pratique manquant au Tome 1 avec ses 1000 pages. La structure de présentation des traitements sylvicoles est bien pensée, car les chapitres sont ordonnés selon une progression logique suivant la vie d’un peuplement forestier. Cela commence donc à La préparation de terrain et se termine à La coupe de jardinage avec cohortes juxtaposées. En continuité avec la logique du Tome 1, la présentation de chaque traitement est uniformisée selon une même structure qui facilite la consultation. J’ai ici particulièrement apprécié la section Justification sylvicole. Je soupçonne que toutes les pages associées à cette section vont être un peu plus «tordues» que les autres!
Guide ou encyclopédie?
La notion de «guide» réfère habituellement à un document «pratique» ou appliqué. Si l’ambition de ce document est clairement «pratique», vous pouvez toutefois percevoir que le fait de cumuler plus de 1700 pages après deux des trois tomes a potentiellement un côté «non pratique». Si je m’attarde au Tome 1, il y a quelque chose d’un peu «lourd» à ouvrir une brique de plus de 1000 pages pour retrouver une information précise sur un point donné. La présentation des différents thèmes abordés dans ce Tome sous forme d’autant de guides aurait, je pense, permis de donner une «aura» plus pratique à l’ensemble.
En fait, si j’ai acheté un Guide, j’ai souvent eu l’impression d’avoir plutôt acquis une encyclopédie. Collaborant à Wikipédia, j’ai a priori un faible pour les encyclopédies! Mais une encyclopédie n’est pas un guide pratique. Si les textes ont été envoyés à des praticiens pour s’assurer qu’ils correspondaient à leurs besoins, je ne suis pas sûr qu’ils s’attendaient à ce format.
À propos du texte
C’est peut-être une déformation de blogueur, mais dans l’optique d’un document s’adressant au plus grand nombre, j’ai trouvé que la lecture pouvait être «aride». Pour préciser, si je mets mon chapeau de Ph. D., je n’ai aucun problème avec le texte. Mais comme ce dernier est avant tout une synthèse d’articles scientifiques, malgré l’effort de vulgarisation cela reste une synthèse bien souvent technique qui pourrait rebuter le «profane», un des publics visés par ce document.
L’élément qui m’a toutefois le plus agacé au niveau du texte est la présence de phrases en gras à l’intérieur de paragraphes dans le Tome 1. C’est là peut-être quelque chose de très personnel, mais s’il est bien de vouloir attirer l’oeil du lecteur sur certaines idées, lorsque l’on met l’accent sur une phrase à l’intérieur d’un paragraphe, le message envoyé est que le reste du texte dans ce paragraphe est négligeable. Pourquoi le mettre alors? Dans le Tome 2, les textes en gras introduisent un paragraphe en faisant ressortir l’idée principale, ce qui donne envie de lire les détails. Dans le Tome 1, on a parfois l’impression d’être dans une mer de mots classés «inutiles».
Un Guide symbolique de notre foresterie
Les points précédents sont de petites critiques qui ne devraient entamer en rien votre appréciation générale du travail colossal que ce Guide a demandé et du résultat de qualité qu’il en est résulté. De fait, ma plus grosse critique n’est pas directement liée au livre, mais à l’état de notre culture d’aménagistes forestiers au Québec que ce Guide fait très bien ressortir.
Cela fait des décennies que l’on aménage les forêts au Québec. Il y a un Ordre des Ingénieurs Forestiers du Québec. On pourrait donc s’attendre dans ce Guide à un apport de premier plan de nos professionnels basé sur leur expérience. Eh bien non. Leur apport «expérience terrain» est exactement égal à zéro.
La raison fondamentale est clairement énoncée à la page 1 du Tome 2:
Les auteurs ont appuyé les affirmations qui sont faites sur des publications scientifiques, en prenant soin d’y inclure les connaissances les plus à jour.
Et être un sylviculteur sur le terrain au Québec n’est à l’évidence pas de la science. Pourtant, de ce que j’ai retenu de mes cours, l’aménagement forestier, comme la sylviculture, se doit d’être à la fois un art et une science. Mais comme il est difficile de réglementer l’art, depuis des décennies notre législation forestière préconise l’application de normes en forêt; normes définies par la science.
Il n’y a aucun mal à se servir de la science! Mais il faut aussi laisser les professionnels réfléchir, car la science ne peut avoir réponse à toutes les situations rencontrées en forêt. Donc, depuis des décennies, nos professionnels mettent leur intelligence à appliquer ou élaborer des normes plutôt qu’à comprendre un territoire forestier. Lorsqu’il y a des critiques sur l’aménagement de nos forêts, c’est une raison qui est trop facilement ignorée.
Ce Guide, et la nouvelle politique forestière sont là pour changer cet état de fait. Tant mieux. Mais il faudra que je le voie pour le croire! Et pour cela, je vais attendre la prochaine version du Guide en espérant y retrouver un apport de «l’expérience terrain».
Un Manuel de Foresterie 2.0?
De par l’ampleur de la tâche qui a été accomplie avec ce Guide, certains peuvent se demander dans quelle mesure il chevauche le Manuel de Foresterie. Même si des éléments se recoupent (le chapitre sur les feux de forêt fait directement référence au Manuel de Foresterie), il faut plutôt voir le Guide comme une loupe sur tous les éléments du Manuel qui touchent la sylviculture. Ce dernier a une portée plus large dans ses thèmes, mais est naturellement moins précis, et maintenant moins à jour, pour la sylviculture.
En conclusion…
Malgré mes doutes sur le fait que le Guide réponde bien à sa mission «pratique» première et mes critiques sur la forme, il n’y aucune raison pour que ce document ne trouve pas sa place dans le monde forestier québécois même s’il est possible que ce ne soit pas celle visée au départ! Alors «oui», je vous le recommande fortement, mais avec quelques nuances.
J’imagine mal quelqu’un se définissant comme professionnel forestier ne pas avoir le Guide. Je le vois aussi très bien dans les mains des étudiants en foresterie dès leur première année. Ils n’auront pas trop de quatre ans pour assimiler le tout. Toutefois, pour quelqu’un qui a peu de bagages techniques en foresterie, mais qui souhaite s’éduquer en sylviculture, le Tome 2 est probablement un meilleur point de départ. En guise de base, je recommanderais alors Les arbres du Québec, un petit guide bien illustré qui vient d’être réédité aux Publications du Québec. Il est moins cher et de format plus pratique que le Tome 1 tout en donnant les principales caractéristiques écologiques de nos essences commerciales.
Bonne lecture!
