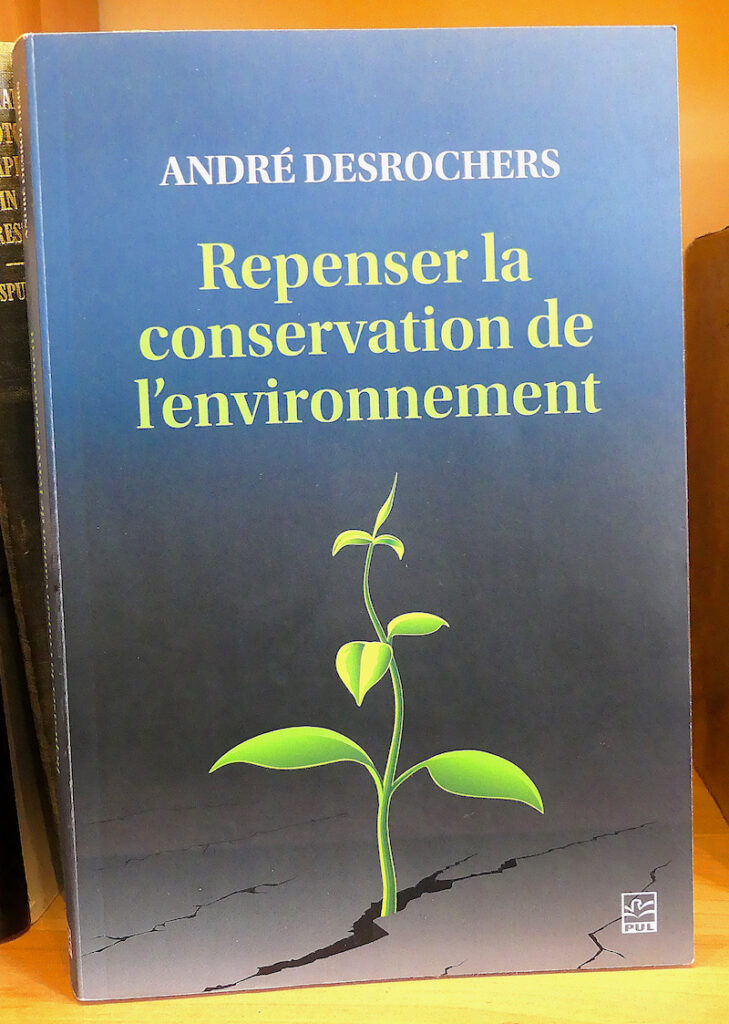«Repenser la conservation de l’environnement» : trois livres en un
Après un hiatus de plus de deux ans, de retour à un compte-rendu de livre! Et pour l’occasion, je mise sur du «local» alors que je vous présente «Repenser la conservation de l’environnement». Un livre écrit par André Desrochers, professeur à la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l’Université Laval, et publié en 2022 aux Presses de cette même université.
Je dois ici souligner que je connais André. Sans être des intimes, nous nous sommes croisés assez fréquemment pour que je pense à «André» et non pas à «M. Desrochers». Il est devenu professeur à la Faculté de foresterie au début des années 1990 alors que je complétais ma maîtrise. Par la suite, nous avons eu l’occasion de nous recroiser au cours de mon doctorat au début des années 2000. Notre dernière rencontre remonte à quelques années alors que nous étions conférenciers au même congrès.
C’est là le contexte personnel dans lequel j’écris ce compte-rendu.
Pour l’aspect professionnel, je dois avouer que si certains passages me font classer ce livre dans les «essentiels», d’autres peuvent décontenancer, voire même laisser songeur. Finalement, on tourne la dernière page sans être trop sûr de ce que l’on doit retenir de l’ensemble. La principale raison étant que le livre a été écrit tant par André Desrochers le chercheur qu’André Desrochers le citoyen politisé.
Détails…
Du livre
L’édition
Le texte compte 251 pages, distribuées en sept chapitres encadrés par une introduction et un épilogue. À cela il faut ajouter 24 pages de bibliographie, soit une abondante documentation à la mesure d’un chercheur universitaire. À défaut d’un index, on y retrouve une table des matières bien détaillée.
Un point de structure que j’ai beaucoup apprécié est que les notes soient en bas de pages et non en fin de livre. Il y a une tendance chez plusieurs éditeurs de regrouper les notes en fin de livre. Je trouve cela très désagréable, car on passe son temps à voyager d’une partie du livre à une autre. Ici, on peut garder le fil de sa lecture alors que toutes les informations sont sur la même page. À cela, il faut ajouter que l’écriture de l’auteur est fort agréable. Les 251 pages se lisent donc très bien.
Une thèse (ultra) optimiste
La trame centrale du livre tient en un mot : optimisme. Le premier paragraphe du 4e de couverture explicite très bien cette idée :
Il ne se passe pas une journée sans qu’on nous alerte à propos d’une crise planétaire, voire d’un effondrement à court terme si l’humanité refuse de changer de cap. Ces annonces génèrent de l’anxiété au sein d’une proportion croissante de la population. Pourtant, la tendance définie par de nombreux indicateurs touchant à l’état de l’environnement et à la condition humaine est encourageante.
— Desrochers, 2022 (4e de couverture)
Sur ce point, l’auteur raconte une anecdote intéressante. Mis au fait de «bonnes nouvelles» environnementales à l’échelle planétaire, plusieurs de ses amis et collègues ont réagi avec déni voire de la colère (p. 52). L’analyse d’André Desrochers est que ces bonnes nouvelles s’opposent à la décroissance prônée par plusieurs pour faire face à nos défis environnementaux. Or, ce livre promeut l’antithèse de cette approche : même s’il peut y avoir des impacts (passagers) sur l’environnement, notre salut collectif passerait par la croissance économique et surtout les innovations technologiques.
À souligner cependant que cette vision (ultra) optimiste de l’humanité est liée à une école de pensée : l’écomodernisme. Et c’est une des sources de mes bémols sur le livre. Je détaille plus loin. Pour l’immédiat, voyons pourquoi vous devriez le lire avant d’expliquer, dans un deuxième temps, pourquoi vous pourriez hésiter.
Pourquoi vous devriez le lire
Des extinctions

Effondrement écologique, sixième extinction… Lorsqu’il est question d’enjeux environnementaux dans l’actualité, ce sont là des thèmes récurrents. La cause semble entendue. Pourtant, il y a des raisons de douter. À tout le moins, d’être moins catastrophique. Et André Desrochers en fait une démonstration bien réussie.
À cet égard, le chapitre 3, intitulé «Les Espèces», est quant à moi le chapitre clé du livre. Il y est question de biodiversité. Enfin, de sujets liés à ce concept. L’auteur jugeant que le mot biodiversité est employé à toutes les sauces, il en parle essentiellement pour dire qu’il n’aime pas l’utiliser…
Un point souligné par André Desrochers est que la grande majorité des espèces composant la biodiversité sont probablement méconnues. Statistiquement, des estimations datant de 2011 font état de 8,7 millions d’espèces d’eucaryotes, soit tous les organismes vivants à l’exclusion des virus et des bactéries (p. 58). De ce total, seulement 1,6 à 1,9 million sont connues. De plus, il fait valoir que depuis les origines de la vie sur notre planète, 99 % des espèces auraient disparu. Cela remet en perspective les peurs liées au phénomène d’extinction des espèces…
À cet égard, une analyse que j’ai trouvé fort intéressante est justement celle concernant les taux d’extinctions des espèces (p. 88). L’auteur montre que cette perception est très dépendante de l’échelle de temps utilisée. Aujourd’hui, le message est que ce taux augmente. Ce qui est effectivement le cas si l’on fait une analyse par siècle.
Toutefois, lorsque l’on transpose les données par décennies, le portrait est très différent. Dans ce cas, les taux d’extinctions des deux derniers siècles (ou 20 dernières décennies) prennent la forme d’une cloche avec un pic autour du début des années 1900. Depuis, la tendance est à la baisse.
Pour autant, ce serait vous induire en erreur que de vous laisser penser qu’André Desrochers considère qu’il n’y a pas de soucis et que tout va très bien sur le front de la biodiversité. Son grand message est que, contrairement à la perception largement diffusée, les choses vont en s’améliorant.
C’étaient là des passages du livre basés sur des statistiques. Mais il est aussi question de philosophie des sciences et de conservation de la biologie. Un sujet que l’auteur maîtrise manifestement très bien.
Conservation n’est pas science
Ici, le point central est qu’il ne faut pas fusionner «science» et «conservation». André Desrochers nous explique qu’en biologie, l’approche de la «conservation» n’est pas une science. C’est plutôt un système de valeurs basé sur les axiomes «[…] la nature est bonne, et le poids de l’action humaine est mauvais.» (p. 31) Et, ce faisant, il y a souvent une tendance à instrumentaliser la science…
De nombreux intervenants veulent donner un rôle normatif plutôt qu’informatif à la science, en clamant : «La science dit…»; ils veulent ainsi laisser croire que la science décide, plutôt qu’eux. […] la science n’a pas d’opinion ni de sentiments, elle n’est qu’une démarche qui opérationnalise des problèmes en les réduisant à des hypothèses falsifiables. Quand on affirme : «La science dit que… est urgent…», on démontre une profonde méconnaissance de ce qu’est en réalité la «science».
— Desrochers 2002, p. 35
Lorsqu’il est question de la conservation de la biodiversité dans l’espace public, le principal message véhiculé est que cela va très mal et que la seule solution passe par une forte diminution de notre empreinte sur la planète. Dans les faits, non seulement beaucoup de nuances doivent être apportées, mais il s’avère aussi que tout n’est pas noir. Loin de là. Fort de sa trentaine d’années d’expérience de recherche dans le domaine, André Desrochers l’explicite très bien et de façon fort pédagogique. Si vous souhaitez ouvrir votre réflexion sur le sujet, c’est clairement un livre à lire.
Mais le livre n’est pas seulement sur la conservation de la biodiversité. Le titre réfère d’ailleurs clairement à «la conservation de l’environnement». C’est cet élargissement dans le champ d’intérêt du livre, couplé à la thèse optimiste de l’écomodernisme, qui peut cependant laisser dubitatif.
Pourquoi vous pourriez hésiter à le lire
L’ingrédient de trop
Dans les quatre premiers chapitres, tout se tient. La notion de conservation se décline sous différents concepts liés à la biodiversité et aussi son histoire, ce qui est fort intéressant. Mais nous arrivons ensuite au chapitre 5 intitulé «Conserver le climat?»
L’auteur justifie ainsi la pertinence de ce chapitre :
Est-ce qu’on doit conserver le climat, au même titre que les forêts, les espèces? Voilà une manière étrange de présenter le problème, direz-vous, mais l’expression lutter contre les changements climatiques, c’est l’essence même de la conservation puisqu’on désire contrer un changement.
— Desrochers 2022, p. 163-64
Je n’ai pas été convaincu par cette justification.
Quant au contenu et l’argumentation que l’on retrouve dans ce chapitre, il m’apparaît ici à propos de sauter immédiatement à sa toute dernière phrase.
Pour l’instant, les informations que nous avons en main indiquent non pas que les humains auraient transformé un climat naturellement sécuritaire en monstre climatique dangereux, mais plutôt le contraire : l’essor des civilisations nous a permis de nous protéger de plus en plus d’un climat naturellement dangereux.
— Desrochers 2022, p. 194
Ici aussi, je n’ai pas été convaincu. Tout au plus curieux, si l’occasion s’y prêtait, d’explorer certains points abordés pour me faire ma propre idée. Mais dans les faits, seules les personnes déjà convaincues par la thèse «climatosceptique» (à défaut d’un meilleur adjectif) ou qui se cherchent une argumentation en ce sens se retrouveront dans ce chapitre. Car, au-delà de sa justification douteuse dans ce livre, ce chapitre souffre de trois grands problèmes.
Tout d’abord, il m’est apparu assez évident que si les quatre premiers étaient écrits par un spécialiste du sujet, le cinquième est le fait d’un amateur éclairé. Même s’il a fait ses devoirs, André Desrochers n’est pas un scientifique du climat. Donc, d’une certaine façon, on peut percevoir que nous ne sommes pas au même niveau de compréhension des enjeux que dans les quatre premiers chapitres. En soi, c’est agaçant.
Aussi, dans la thématique «compréhension des enjeux», si vous vous êtes moindrement intéressés à la science du climat, il y a un point qui a dû vous frapper : c’est très très complexe. Il y a une myriade de variables à considérer sans compter leurs interactions. Si vous souhaitez en plus défendre une thèse climatosceptique, il faut démontrer une compréhension de l’ensemble, et pas seulement de quelques parties. Pour cela, il convient d’écrire un livre sur le sujet et non pas un chapitre dans un livre avec une autre thématique en vedette.
En suite de cette idée, il faut finalement penser à son lectorat…
Le lecteur qui s’intéresse aux questions de conservation de la biodiversité n’est pas nécessairement le même que celui qui souhaite s’investir dans la (complexe) science du climat. Dans le même livre. Ce sont deux mondes.
Pour résumer le problème avec ce chapitre, je vais faire une analogie avec les compétitions culinaires télévisuelles. Il y a toujours un concurrent qui finit par se faire reprocher d’avoir mis un ingrédient de trop dans son plat. Il a bien apprêté ses aliments principaux, mais il a décidé d’ajouter une épice ou un autre ingrédient pour donner plus de goût. Problème : les saveurs associées aux ingrédients principaux s’en trouvent masquées. Et c’est ce qui arrive avec le chapitre 5. Après l’avoir lu, les quatre précédents ont tendance à tomber dans l’oubli. Et c’est fort dommage.

L’écomodernisme : l’école de pensée positive sur l’humanité
Disons maintenant quelques mots sur la thèse écomoderniste défendue par l’auteur et que l’on retrouve en filigrane tout au long du livre. Elle est associée à la vision «optimiste» discutée plus haut. Le dernier chapitre lui est consacré. Pour l’expliquer, le plus simple est d’y aller avec les mots de l’auteur :
Dans le dernier chapitre de ce livre, je présente et défends la thèse écomoderniste. Cette perspective, développée par un groupe international de chercheurs et d’autres penseurs, stipule que l’avenir des écosystèmes naturels et de l’humanité réside dans un découplage de l’humain et de l’environnement. Dans cette vision humaniste, celles qu’on appelle les ressources naturelles sont vues comme tendant vers l’inutilité au sens de matières premières; l’action est plutôt dirigée vers une intensification des activités de production d’énergie et de denrées qui libèrerait de vastes espaces que l’on pourrait redonner à la nature. En bref, comme les autres écomodernistes, je vois la croissance de l’entreprise humaine, et non pas son repli, comme remède aux maux de la planète. À l’instar du physicien David Deutsch, je vois les humains comme des designers, des pilotes plutôt que des passagers béats et impuissants du vaisseau spatial Terre.
— Desrochers 2022, p. 4-5
Pour donner mon point de vue sur le sujet, je dirais que ne suis pas gagné à cette thèse. Mais le point central ici n’est pas l’opinion que l’on peut en avoir, mais le fait qu’elle teinte tout le livre. Ce qui pourrait légitimement amener certains à douter de la valeur intrinsèque d’un livre écrit «sous l’égide » d’une philosophie de développement économique. Et cela est fort malheureux.
Mot de la fin
Après plus de 200 chroniques et un livre, j’ai pu constater que le plus difficile dans l’écriture est de décider de ce que je ne publie pas.
J’aborde toutes mes chroniques avec un tas d’idées. Très souvent, certaines m’apparaissent a priori presque incontournables, mais elles disparaissent avant la publication. C’est arrivé pour ce texte.
Si l’on écrit, c’est pour être lu. Pour cela, il ne faut pas perdre son lecteur. C’est pourquoi il faut éviter de s’éparpiller et s’en tenir à une idée centrale. C’est à tout le moins ma philosophie d’écriture…
C’est un exercice toujours difficile. Je ne prétends pas réussir à tout coup. Mais c’est là où réside le problème central de ce livre : on lit un livre ainsi que les prémisses de deux autres.
Le livre aurait pu se finir avec le chapitre 4 et avoir pour titre «Repenser la conservation du vivant». C’est déjà là un vaste projet! Les éléments discutés dans le chapitre 5 auraient pu être incorporés dans un livre qui s’intitule «Les changements climatiques? Même pas peur!» Quant à la thèse écomoderniste, elle aurait pu être portée par le livre «L’avenir radieux de l’humanité».
Mais dans les faits, les trois sont regroupés dans un même ensemble qui, justement, ne fait pas un «ensemble». Et ici, je dois dire que je pense plus à l’éditeur qu’à l’auteur. C’est, me semble-t-il, la responsabilité de l’éditeur d’aviser l’auteur qu’il s’égare un peu…
En conclusion, «Repenser la conservation de l’environnement» est un livre essentiel si vous souhaitez ouvrir vos horizons sur tout le grand sujet de la conservation de la biodiversité. Mais vous allez y retrouver beaucoup plus que cela et vous pourriez vous sentir un peu perdus. Soyez-en avisés.