Une histoire mondiale de la foresterie scientifique
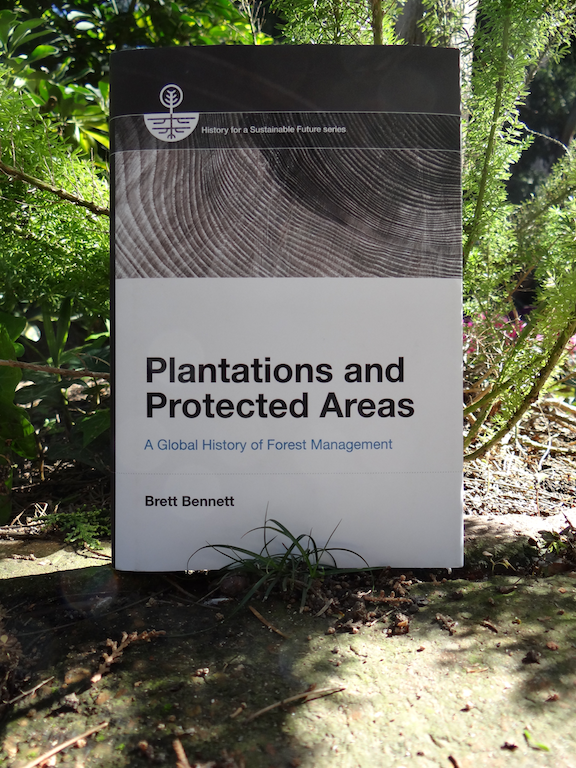 Pour ce compte-rendu du livre « Plantations and Protected Areas: a global history of forest management », je suis exceptionnellement tenté de vous proposer de d’abord relire celui de « Science and Hope: a forest history »… Ce que j’ai personnellement fait ! Il faut dire que les deux livres racontent pratiquement la même histoire, mais avec des regards différents. Ils ont aussi comme point commun d’avoir été écrits en partie par des Australiens (et une Autrichienne pour « Science and Hope ») et d’avoir fait le pari, réussi dans les deux cas, de donner une vision mondiale de l’histoire de la foresterie scientifique. La lecture de ces deux livres offre donc un très bon regard d’ensemble de cette histoire ainsi que de l’évolution du rôle des forestiers au cours des trois derniers siècles.
Pour ce compte-rendu du livre « Plantations and Protected Areas: a global history of forest management », je suis exceptionnellement tenté de vous proposer de d’abord relire celui de « Science and Hope: a forest history »… Ce que j’ai personnellement fait ! Il faut dire que les deux livres racontent pratiquement la même histoire, mais avec des regards différents. Ils ont aussi comme point commun d’avoir été écrits en partie par des Australiens (et une Autrichienne pour « Science and Hope ») et d’avoir fait le pari, réussi dans les deux cas, de donner une vision mondiale de l’histoire de la foresterie scientifique. La lecture de ces deux livres offre donc un très bon regard d’ensemble de cette histoire ainsi que de l’évolution du rôle des forestiers au cours des trois derniers siècles.
Là où « Plantations and Protected Areas » se distingue toutefois, c’est par la plus grande place qu’il accorde à la réflexion et à l’interprétation de l’histoire. Je le précise immédiatement : il reste pour autant un livre d’histoire très factuel, il n’est certainement pas à classer dans la catégorie « essais » ! Alors que les auteurs de « Science and Hope » s’en tenaient exclusivement aux faits, celui de « Plantations and Protected Areas » (M. Brett Bennett) se donne seulement un peu plus de liberté. C’est d’ailleurs là une des raisons qui m’amène à vous recommander de lire « Science and Hope » en premier : il donne la (très solide) base. Avec « Plantations and Protected Areas », vous la revisitez tout en ouvrant plusieurs fenêtres de réflexion. Sur ce, « compte-rendu » !
Allemagne : feu le piédestal
Le « grand modèle » de l’histoire de la foresterie scientifique a pour source l’Allemagne. C’est en Allemagne que seraient nés et d’où auraient été diffusés les grands concepts toujours au cœur de la foresterie scientifique d’aujourd’hui. Pour M. Bennett, s’il va de soi que l’Allemagne est un acteur important de l’histoire forestière scientifique mondiale, ce n’est cependant… qu’un acteur parmi d’autres. C’est là le point central de la dimension « interprétation » qu’apporte l’auteur.
Fondamentalement, pour M. Bennett, il n’y a pas une, mais des sources de foresterie scientifique. Plutôt qu’une histoire avec un seul cœur, il serait donc en fait plus approprié de parler d’une grande histoire de coévolution stimulée par la mondialisation. Il remonte l’origine de cette mondialisation « forestière » à cinq siècles. Elle aurait amené les différents acteurs à se nourrir mutuellement des expériences des autres tout en s’adaptant à leurs particularités territoriales (écologie, situations politiques et sociales…).
M. Bennett donne plusieurs raisons bien argumentées pour étayer son propos sur la « non-centralité » de l’Allemagne dans l’histoire de la foresterie scientifique. L’argument qui m’a le plus frappé, peut-être car teinté de cynisme, est que les Allemands ont été particulièrement forts pour écrire leur propre histoire ! Je précise ici qu’il s’agit d’une des rares touches éditoriales du livre.
Aussi intéressante et bien argumentée que puisse l’être cette vision de l’histoire de la foresterie scientifique, elle a cependant pour moi le défaut d’être présentée trop « brutalement » au début du livre, ce qui peut donner l’impression que l’auteur a une dent personnelle contre la foresterie allemande (ça m’a effleuré l’esprit) ! D’un autre côté, avec le recul, on peut comprendre que l’auteur souhaitait immédiatement briser nos idées préconçues pour nous présenter sa vision. Car il faut insister sur le fait qu’il ne s’agit là que d’une interprétation de l’histoire, très bien argumentée, mais qui demeure une interprétation (seul le temps dira si elle s’imposera).
Deux grandes stratégies mondiales d’aménagement forestier
L’histoire que nous présente M. Bennett se décline en deux grands mouvements. Tout d’abord on voit apparaître l’avènement d’une grande stratégie mondiale d’aménagement des forêts basée sur le principe de la conservation. Dans un deuxième temps, surtout après la 2e guerre mondiale, cette stratégie de conservation est graduellement remplacée par une stratégie axée sur la dichotomie « aires protégées — plantations ».
La stratégie de « conservation » se caractérise par des forêts qui sont dédiées à la fois à l’approvisionnement en bois et à la protection d’autres ressources, comme les forêts nationales américaines (exemple le plus proche de nos contrées cité par l’auteur). Dans cette stratégie, l’État et les forestiers jouent un rôle central, ces derniers ayant en fait presque un statut de « rois de la forêt »… une couronne qu’ils devaient toutefois perdre dans la foulée des grands bouleversements qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale.
Après cette guerre, et pour différentes raisons expliquées plus bas, la stratégie de « conservation » va progressivement laisser sa place à celle basée sur la dichotomie « aires protégées – plantations » qui pourrait se résumer ainsi : « Finis les compromis, on protège complètement ou l’on récolte du bois ».
Des causes de l’évolution des stratégies d’aménagement et de ses impacts sur les forestiers
M. Bennett met en relation plusieurs éléments pour expliquer à la fois la popularité croissante de la stratégie d’aménagement « aires protégées – plantations » et la perte de réputation des forestiers comme intendants du milieu forestier. Les deux allant de pair, car cette stratégie implique justement de diminuer l’influence des forestiers en forêt.
Tout d’abord, après la 2e guerre mondiale, la demande en produits du bois s’est grandement accrue. Les forestiers, qui historiquement avaient cherché à concilier différentes ressources à même une forêt (« conservation ») ont alors mis l’accent sur la production de bois avec, à la clé, une plus grande utilisation des coupes à blanc. Or, s’il y a un point qui est très clair dans le livre, c’est que ce type de coupes est universellement honni ! En parallèle, les partisans de la protection des forêts avaient aussi changé. L’histoire de cette évolution est d’ailleurs une section particulièrement intéressante du livre.
M. Bennett nous explique que les concepts de conservation et de protection coexistent depuis très longtemps. Dans un passé pas si lointain, les partisans de ces deux options se percevaient comme faisant partie d’un même gradient d’utilisation des forêts plutôt que d’être en confrontation. Il donne d’ailleurs l’exemple de M. John Muir, le grand naturaliste américain, fondateur du Sierra Club et ardent promoteur des parcs, qui intégrait ces derniers dans une vision plus large d’utilisation des forêts dont la récolte de bois. Une raison sociale expliquerait l’esprit historique de non-confrontation entre les partisans de ces deux groupes : ils provenaient du même « sérail » anglo-saxon. Pour imager, les débats se faisaient alors davantage dans des salons feutrés qu’à l’aide de caméras et appareils-photo… Cela changera du tout au tout après la 2e guerre mondiale.

Redwood National Park en Californie (Auteur: Michael Schweppe, Source: Wikimedia)
M. Bennett nous présente alors le cas des forêts de séquoia géant de la côte ouest américaine et l’histoire de l’environnementaliste David Brower du… Sierra Club. Alors que ces forêts spectaculaires sont coupées à blanc, M. Brower eut l’idée de prendre des photos du résultat des opérations forestières. Cela devait donner naissance au livre « The Last Redwoods » (1963) ainsi qu’à plusieurs campagnes publicitaires dans les grands journaux ; des initiatives qui connurent toutes un franc succès. Ces succès montrèrent la voie à une nouvelle génération de « protecteurs » de la forêt avec des approches plus agressives et en rupture avec les « conservationnistes ». Cela représenta aussi un premier grand jalon dans la mise en disgrâce des forestiers comme bons intendants des forêts. À cet égard, M. Bennett précise que cette disgrâce fut d’autant plus rapide que :
« Foresters were caught off guard by the intensity of public criticisms because they imagined themselves to be the true environmental stewards of forests. » (p. 101)
Des plantations
Le volet « plantations » se voit consacrer un chapitre complet et quiconque se cherche une référence historique sur le sujet devrait y trouver son compte. On y retrouve à cet égard plusieurs des histoires présentées dans « Science and Hope », dont celles sur les plantations de l’Europe centrale ainsi que le cas particulier des Landes françaises.
Dans « Plantations and Protected Areas », l’auteur creuse cependant un peu plus l’histoire de l’utilisation des pins du sud des États-Unis et de l’eucalyptus pour la production de papier. On y apprend entre autres que les succès des plantations d’eucalyptus d’aujourd’hui font suite à un siècle d’échecs successifs (les premiers essais avaient commencé au 19e siècle). Autant c’est une essence avec un potentiel de croissance incroyable, autant elle a représenté un défi scientifique pour arriver à la faire croître en plantations.
Comme pour le reste de l’histoire que nous raconte M. Bennett, la Seconde Guerre mondiale représente un point de bascule. Les succès scientifiques, technologiques et la demande pour les produits du bois aidants, les plantations cessèrent progressivement d’être un moyen pour atteindre une fin (ex : reboiser) et devinrent une fin en soi. Ce chapitre s’intitule d’ailleurs fort justement « Plantations : From Security to Profitability ».
Un des grands changements qui en découla fut l’implication de plus en plus prononcée de l’entreprise privée dans le « business » des plantations. Aux États-Unis, l’intérêt de la Weyerhaeuser pour ce « business » après la Seconde Guerre mondiale l’amena d’ailleurs à utiliser le slogan « Timber is a crop. ».
Pour donner la mesure de la place que prennent les plantations dans le monde forestier, à la sortie de la 2e guerre mondiale, l’auteur fait état qu’elles ne représentaient que 0,2 % du couvert forestier mondial contre 7 % en 2010 (note : 50 % de ces plantations étaient alors en Asie). En 2000, les plantations classées comme « intensives » ne représentaient que 3 % du couvert forestier mondial, mais 30 % du volume récolté à des fins industrielles ; un pourcentage qui devrait s’accroître à 50 % pour 2020.
Points finaux
À cette étape de la chronique, et comme cela m’arrive de plus en plus régulièrement, je me demande comment j’ai pu faire pendant très longtemps pour écrire des textes en moins de dix paragraphes ! Comme il est clair que je ne pourrai creuser tous les aspects d’intérêt dans un espace raisonnable, je vais donc compléter avec quelques points :
- M. Bennett est très critique de la dynamique en cours pour la stratégie « aires protégées – plantations ». Parmi les problèmes qu’il note dans cette stratégie, il y a le fait que les forêts ont besoin d’être aménagées pour faire face, entre autres, aux changements climatiques. Or, non seulement les aires protégées limitent les possibilités d’intervention, mais les plantations intensives et leurs profits associés étant surtout liés à l’industrie, l’État se trouve à perdre une source de revenus pour aménager ses forêts. Cela crée une dynamique négative et pour la briser M. Bennett souhaiterait un retour à une stratégie de conservation… qui ressemble aux aires protégées polyvalentes que j’ai présentées dans ma précédente chronique !
- À l’instar de « Science and Hope », les forestiers sont loin d’avoir toujours le beau rôle. Malgré tout l’auteur leur réserve de bons mots pour la fin et considère que leur formation unique les rend idéalement placés pour jouer un rôle de premier plan dans l’aménagement futur des forêts.
- C’est un livre qui fait voyager de par le monde et, je le réalise, cela ne paraît pas à sa juste valeur dans mon compte-rendu !
- Finalement, il est bon de noter que ce livre de l’éditeur MIT Press (Cambridge, États-Unis) fait partie de la même série que celui sur les Commons que j’avais présenté l’automne dernier, soit « History for a sustainable future »… Une série que je vais continuer à suivre !


